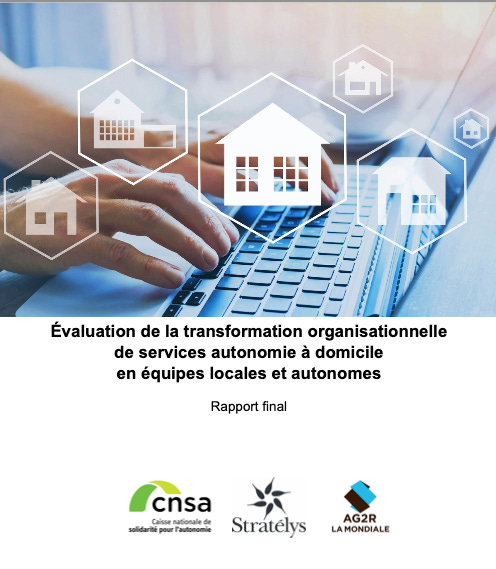ELA dans l'aide à domicile : le modèle Buurtzorg à la française marche, mais coûte cher
Les Équipes Locales Autonomes testées par la CNSA transforment la qualité de vie au travail. Le hic ? Elles font chuter la productivité de 8 points. Et personne ne veut en payer le prix.
Welcome sur Longévité, la newsletter qui décrypte la Silver économie. Et qui décortique, pour vous, le récent rapport CNSA / AG2R / Stratelys sur l’expérimentation des équipes locales autonomes, ces Buurtzorg à la française.
Avec cette analyse, je veux d’une part vous épargner la lecture fastidieuse d’un rapport de 200 pages, mais aussi vous aider à répondre à LA question :
Comment transposer les bonnes pratiques inventées par Buurtzorg dans ma boîte de services à la personne, en France ?
Le mythe fondateur et ses malentendus
Depuis qu’un infirmier néerlandais nommé Jos de Blok a révolutionné les soins à domicile aux Pays-Bas en 2006, son modèle Buurtzorg fait fantasmer le secteur médico-social français.
L’histoire est belle :
Des petites équipes autonomes de soignants qui s’auto-organisent,
Zéro hiérarchie intermédiaire,
Des patients ravis,
Des professionnels épanouis,
Des économies substantielles pour la sécurité sociale.
La totale !
Le succès est tel qu’en France, le modèle inspire désormais au-delà de la simple observation.
L’expérimentation “Équilibres” (Article 51), lancée en 2018 auprès des infirmiers libéraux, vient d’obtenir son feu vert pour la généralisation. Avec 180 infirmiers impliqués et 25 000 patients suivis, le dispositif affiche des résultats spectaculaires : 9 millions d’euros d’économies par an grâce à la réduction des hospitalisations, et un retour d’expérience très positif des professionnels. La preuve que ça marche... pour les infirmières.
Entre 2020 et 2024, la CNSA et AG2R LA MONDIALE ont décidé de tester une adaptation de cette promesse dans l’aide à domicile. Quatre Services Autonomie à Domicile (SAD) se sont lancés dans l’aventure. Les résultats viennent de tomber. Et ils racontent une histoire plus nuancée que le conte hollandais, tout en confirmant l’intérêt du modèle.
Clarifier avant d’analyser
Avant d’aller plus loin, clarifions un point essentiel souvent négligé : Buurtzorg est un service de soins infirmiers, pas un service d’aide à domicile. Les équipes sont composées d’infirmières diplômées, pas d’auxiliaires de vie.
Ce que ça veut dire
Primo, une infirmière jouit d’une autonomie décisionnelle et d’une lattitude d’intervention sans commune mesure avec celle d’une aide à domicile. Elle peut prescrire des soins, ajuster les protocoles, coordonner avec les médecins. Elle travaille déjà en relative autonomie dans le système de santé néerlandais.
Deuzio, le mode de financement de Buurtzorg repose sur un tarif horaire simplifié (entre 57 et 72€ de l’heure aux Pays-Bas), quelle que soit la nature des actes réalisés pendant la visite. Cette simplification administrative élimine la complexité de la nomenclature des actes et permet une vraie liberté d’organisation. L’expérimentation française “Équilibres” a d’ailleurs adopté ce principe avec un tarif de 53,94€ de l’heure pour les infirmiers libéraux, calculé en fonction du temps réellement passé auprès du patient. Aux Pays-Bas, une infirmière Buurtzorg peut enchaîner 8 à 12 interventions par jour, des actes techniques et rémunérateurs.
En France, l’aide à domicile intervient sur des plages horaires, souvent pour des tâches de la vie quotidienne, avec une tarification à l’heure qui impose une logique de productivité très différente. Les infirmiers d’Équilibres conservent leur statut libéral et interviennent sur prescription médicale, là où les aides à domicile dépendent de plans d’aide établis par les départements.
Ces différences structurelles expliquent pourquoi l’expérimentation française dans l’aide à domicile ne cherchait pas à copier Buurtzorg tel quel, mais à en adapter les principes à une réalité très différente. Un exercice d’hybridation nécessaire et intelligent.
Ce qui marche vraiment dans l’expérimentation française
L’expérimentation menée par la CNSA démontre que, même dans le contexte contraint de l’aide à domicile française, l’organisation en équipes autonomes produit des effets positifs mesurables.
La révolution de la qualité de vie au travail
C’est le succès indéniable de l’expérimentation, celui qui justifie à lui seul de s’y intéresser. Les chiffres sont éloquents : 86% des intervenants des équipes transformées se disent en accord avec les décisions prises collectivement. Un tiers a un projet de formation continue, contre seulement 7% dans les équipes classiques. La capacité à modifier leurs plannings bondit de 55% à 85%.
Au-delà des statistiques, c’est le quotidien qui change. L’isolement caractéristique du métier – naviguer seul de domicile en domicile sans jamais croiser ses collègues – disparaît. Les réunions d’équipe régulières créent un espace de partage, de résolution collective des problèmes, de transmission des savoirs. “Désormais, nous nous connaissons toutes... Nous ne sommes plus seules. On se sent soutenues”, témoigne une intervenante.
Cette cohésion se traduit concrètement : connaissance collective des usagers, réactivité accrue, communication fluidifiée. Les remplacements ne sont plus synonymes d’angoisse pour les personnes accompagnées. La sectorisation géographique réduit la fatigue liée aux déplacements.
L’autonomie retrouvée dans la gestion des plannings, la reconnaissance des compétences, le sentiment de contribuer aux décisions : tout cela transforme le rapport au travail. Dans un secteur en crise de vocation, ce n’est pas anecdotique.
La qualité de service : des progrès mesurables mais incomplets
L’évaluation CNSA a identifié huit améliorations significatives de la qualité d’accompagnement, toutes totalement observées dans les quatre structures testées.
La relation de confiance entre intervenants et personnes accompagnées s’est renforcée, favorisée par la proximité et la régularité des passages. L’adaptation aux habitudes de vie s’est améliorée grâce à une meilleure connaissance globale de la personne : ses besoins, ses appétences, ses proches, son environnement. Cette connaissance approfondie résulte directement des réunions régulières et des échanges facilités au sein des équipes.
La continuité de l’accompagnement s’est nettement renforcée. La coordination interne bénéficie désormais d’une astreinte technique au sein de chaque équipe, et la polyvalence des intervenants permet des remplacements plus aisés. Quand un membre de l’équipe est absent, ses collègues connaissent déjà la personne accompagnée et peuvent assurer la continuité sans rupture.
L’adaptation des plannings aux contraintes et besoins des usagers est devenue effective. Les horaires sont co-construits et ajustés lors des réunions d’équipe, offrant une flexibilité auparavant impossible. La réactivité face aux problématiques d’accompagnement s’est également améliorée : les difficultés sont abordées collectivement, permettant de trouver des solutions plus rapidement. Conséquence mesurable : une baisse des plaintes et réclamations dans les services.
Mais l’évaluation révèle aussi des limites importantes. Les projets personnalisés ne sont pas formalisés dans les quatre structures testées, ce qui constitue un obstacle à la pleine personnalisation de l’accompagnement.
Le suivi et la traçabilité de l’évolution restent partiellement observés : la culture de l’écrit reste à développer chez les intervenants, et les comptes rendus de réunions sont absents dans les quatre structures.
Plus problématique encore : la coordination avec les réseaux de santé externes (infirmiers libéraux, SSIAD, médecins) reste limitée. Il n’existe pas d’outil de coordination commun avec les autres acteurs, et les retours d’information sont majoritairement assurés par le responsable de secteur, comme avant la transformation. Le développement d’une communauté de pratiques professionnelles avec les acteurs de santé n’a pas été observé.
Enfin, l’impact sur la prévention de la perte d’autonomie, le développement du lien social ou le soutien aux aidants n’a pas pu être démontré. Les services n’ont pas modifié leur offre pour proposer des ateliers collectifs ou des liens structurés avec les ressources de répit.
Une donnée manque cruellement : l’évaluation n’a pas mesuré directement la satisfaction des usagers et de leurs familles par des enquêtes externes. Les améliorations observées le sont du point de vue des professionnels et de l’organisation. Pour avoir une vision complète, il faudrait compléter cette étude par des enquêtes de satisfaction indépendantes auprès des bénéficiaires.
Le grand mensonge de l’efficience économique
Parlons cash : non, le modèle ne génère aucune économie. Pire, il coûte plus cher.
Le taux de facturation chute de 8 points en moyenne. Pas parce que les équipes travaillent moins, mais parce qu’elles passent du temps en réunions, en coordination, en construction collective. Du temps essentiel à la qualité du service, mais du temps non facturable dans un système où tout se mesure à l’heure d’intervention.
Les coûts d’encadrement ne baissent pas. Le responsable de secteur change de casquette – moins de planification administrative, plus de coaching – mais il ne disparaît pas. La rémunération horaire augmente légèrement dans les équipes transformées, tout comme les temps de travail annuels.
Certes, certains coûts diminuent : indemnités kilométriques grâce à une meilleure sectorisation, absentéisme et turn-over dans certaines structures. Mais ces économies marginales ne compensent pas l’augmentation globale.
Le bilan est sans équivoque : la productivité mesurée en taux de facturation baisse de 8 points, les coûts d’encadrement sont transférés mais pas réduits, les coûts salariaux augmentent légèrement. En face, on observe une baisse modérée des frais de déplacement et une réduction variable de l’absentéisme selon les structures. Au global, pas d’économies nettes.
Ce n’est pas un échec du modèle. C’est la fin d’une illusion. Celle qu’on pourrait améliorer drastiquement les conditions de travail tout en maintenant la même productivité. Le temps de coordination, c’est le prix de la qualité. Vouloir les deux était de toute façon irréaliste.
Le problème, c’est qu’on a parfois vendu l’expérimentation sur la promesse d’économies à la Buurtzorg. Or, aux Pays-Bas, les économies proviennent notamment de la réduction des hospitalisations et de l’usage optimisé des heures prescrites – des leviers qui n’existent tout simplement pas dans l’aide à domicile française. Comparer les deux relève de la confusion des genres.
Les contraintes structurelles françaises
L’expérimentation révèle 4 obstacles majeurs qui expliquent pourquoi l’autonomie reste partielle en France.
1/ Les systèmes d’information inadaptés
Les logiciels métiers actuels ne permettent ni accès partagé aux plannings ni messagerie sécurisée intégrée. Les équipes bricolent avec WhatsApp ou Signal sur leurs téléphones personnels, posant des questions de sécurité des données (RGPD) et brouillant la frontière entre vie pro et perso. Sans outils adaptés, l’autonomie reste théorique.
2/ Le financement à l’heure : un carcan
La tarification à l’heure de l’APA et de la PCH impose une logique de “temps productif” qui pénalise mécaniquement tout temps de coordination. Chaque minute en réunion est une minute non facturée, donc une perte de revenus. À l’inverse, le système de tarification simplifié de Buurtzorg permet une vraie liberté d’organisation. Sans évolution du mode de financement français, le modèle reste économiquement bancal.
3/ La culture managériale en mutation
Transformer des managers-contrôleurs en managers-coachs ne s’improvise pas. C’est un changement culturel qui demande formation, accompagnement et temps. Beaucoup de responsables de secteur ont construit leur légitimité sur leur capacité à “faire tourner” les plannings. Leur demander de lâcher prise pour devenir des facilitateurs, c’est leur demander de réinventer leur métier.
4/ L’autonomie encadrée, pas totale
Dans l’expérimentation, les équipes gèrent leurs plannings, mais pas le recrutement (transféré dans un seul des quatre SAD), ni les missions administratives complexes, ni la relation avec les financeurs. Le responsable de secteur conserve un rôle de garant du cadre. Ce n’est pas un bug, c’est une adaptation pragmatique aux réalités réglementaires françaises.
Les trois vérités que personne ne veut entendre
Pour les décideurs qui voudraient se lancer, l’évaluation distille des enseignements à intégrer.
Vérité n°1 : La qualité a un prix qu’il faut assumer
Les 8 points de baisse du taux de facturation ne sont pas un problème à résoudre, c’est le coût incompressible de la qualité. Ce temps de coordination doit être explicitement reconnu et financé, par exemple via les CPOM. Le considérer comme un “coût improductif” condamne l’initiative. C’est un investissement dans la prévention, la personnalisation, la qualité de la relation – tout ce que le secteur prétend valoriser mais refuse souvent de financer.
Vérité n°2 : Le changement est culturel, pas structurel
Le succès repose sur un accompagnement au changement réussi, pas sur un organigramme redessiné. L’investissement critique est humain : former les managers à leur nouveau rôle, co-construire le projet avec les équipes. La “charte d’équipe” n’est pas un document administratif mais l’outil central pour opérationnaliser la transformation. Sans cette co-construction, l’autonomie reste un concept creux.
Vérité n°3 : Sans revalorisation, le modèle reste incomplet
Les responsabilités et compétences accrues ne se traduisent par aucune reconnaissance financière. À court terme, l’amélioration de la QVT compense peut-être. Mais à moyen terme, cette absence de reconnaissance salariale freinera l’attractivité. Dans un secteur où les bas salaires sont la première cause de fuite, l’autonomie rend cette question encore plus criante.
La vraie question : faut-il attendre la CNSA pour innover ?
L’expérimentation CNSA/AG2R LA MONDIALE a le mérite d’avoir testé le modèle à grande échelle et d’en avoir mesuré rigoureusement les effets. Elle apporte une validation scientifique précieuse.
Mais elle soulève aussi une question dérangeante :
Fallait-il vraiment quatre ans d’expérimentation institutionnelle pour savoir que l’autonomie améliore la QVT ?
Certaines structures n’ont pas attendu. Elles expérimentent déjà des formes de partage des responsabilités managériales, adaptent leurs organisations, testent des modèles hybrides. Sans financement spécifique de la CNSA. Sans label “expérimentation”. Juste parce qu’elles sont convaincues que c’est la bonne direction et qu’elles sont prêtes à en assumer les coûts.
3 questions en cascade :
Qu’est-ce qui empêche le système français de se réinventer tout seul ?
Pourquoi un modèle qui améliore significativement la QVT aurait-il besoin d’une validation institutionnelle pour se déployer ?
Les structures qui le souhaitent ne pourraient-elles pas simplement s’y mettre, comme Jos de Blok l’a fait en 2006 ?
La réponse tient en partie dans le mode de financement
Tant que la tarification à l’heure pénalisera le temps de coordination, les structures qui s’engagent dans cette voie le font au prix d’une baisse de productivité qu’elles doivent absorber.
C’est le même problème que pour le care management.
Opter pour un Buurtzorg like ou du care management intégré, c’est faire un choix stratégique fort, qui mise sur l’attractivité et la fidélisation des professionnels pour compenser la perte de marge.
Mais c’est aussi une question de culture et de courage managérial. Transformer son organisation en équipes autonomes demande de lâcher prise sur le contrôle, de faire confiance aux équipes de terrain, d’accepter une période de transition inconfortable. Beaucoup de directions ne sont pas prêtes à franchir ce pas sans le parapluie rassurant d’une expérimentation institutionnelle.
L’expérimentation CNSA aura peut-être ce mérite : donner aux hésitants la légitimité et les arguments pour se lancer. Mais ceux qui n’ont pas besoin de cette validation peuvent avancer dès maintenant. Le modèle est documenté, les bénéfices sont mesurés, les écueils sont identifiés. Il ne manque plus que la volonté.
Conclusion : L’autonomie comme choix stratégique
L’expérimentation CNSA démontre qu’on peut améliorer significativement la qualité de vie au travail des aides à domicile en adoptant une organisation en équipes autonomes. Les bénéfices sont réels et mesurables. Le coût aussi.
Cette transformation n’est pas une copie de Buurtzorg – elle ne pourrait pas l’être – mais une adaptation intelligente de ses principes à la réalité de l’aide à domicile française. Une hybridation nécessaire qui tient compte de nos contraintes structurelles tout en visant les mêmes objectifs : redonner du sens au travail, améliorer la qualité de l’accompagnement, fidéliser les professionnels.
La question n’est donc pas “comment répliquer Buurtzorg ?” mais “sommes-nous prêts à investir dans un modèle qui améliore la qualité au prix d’une productivité moindre ?”
Pour les structures qui répondent oui, le chemin est maintenant balisé. Elles n’ont pas besoin d’attendre une généralisation institutionnelle ou de nouveaux financements publics. Elles peuvent s’y mettre, adapter le modèle à leur contexte, en assumer les coûts. C’est un pari sur l’avenir : celui que l’attractivité et la fidélisation des professionnels compenseront la baisse de productivité immédiate.
Pour les pouvoirs publics, le message est clair : si vous voulez encourager cette transformation, facilitez-la plutôt que de la piloter. Assouplissez les financements pour valoriser le temps de coordination. Financez des outils numériques adaptés. Formez les managers aux nouvelles postures. Mais laissez les structures expérimenter, ajuster, inventer leurs propres modèles hybrides.
Car au fond, la vraie force de Buurtzorg n’était pas son organisation spécifique, mais sa capacité à se réinventer en permanence, équipe par équipe, territoire par territoire. C’est cette agilité-là qu’il faut importer, pas un organigramme figé.
Dans l’épilogue, réservé aux abonnés premium, je vous propose un mini-guide pratique pour implémenter les bonnes recettes de Buurtzorg dans les services à la personne.