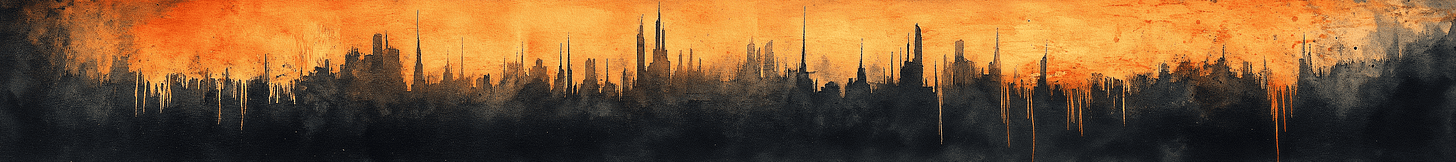Comment les EHPAD pourraient devenir aussi désirables que le black metal satanique norvégien (si, si)
Les stratégies qui ont transformé un genre musical diabolisé en succès mondial peuvent-elles sauver l'institution la plus redoutée de France ?
Bienvenue dans Longévité, la newsletter où, chaque dimanche et mercredi matin, je vous propose des analyses de la Silver économie que vous ne trouvez nulle part ailleurs.
Avant-hier, j’ai lu dans The Conversation une étude très amusante sur les stratégies employées par les labels norvégiens pour populariser le Black Metal malgré sa réputation déplorable, due en grande partie aux comportements criminels des artistes le pratiquant.
Mon premier réflexe a été de le partager à Frank Nataf, le président de la Fedesap qui est comme moi un fan de Metal.
Et puis, j’ai eu une autre idée.
Je me suis dit que ce serait amusant d’appliquer cette stratégie de diversion aux EHPAD, parce que - à l’instar du Black Metal - ces établissements ont une réputation dégradée et il ne semble pas possible d’en sortir en se contentant d’apporter des gages de bonne volonté.
Je vous invite donc à découvrir la stratégie qui a permis aux labels norvégiens de transformer le pépin en pépite.
Et d’imaginer, avec moi…
Comment appliquer à l’EHPAD une stratégie disruptive pour transformer le pépin en pépite ?
En 20 ans, le Hellfest est passé d'un rassemblement confidentiel considéré comme l'antre des satanistes, bruiteurs et marginaux en tous genres, à un événement culturel majeur dont la renommée mondiale dépasse de très loin les seuls fans de Metal (ceux qui en écoutent toute l'année et dorment dans leur veste à patchs).
Pendant ce temps, à l'autre bout du spectre sociétal, les EHPAD peinent à se défaire d'une image de mouroirs médicalisés, malgré leur rôle crucial dans l'accompagnement du grand âge.
Cette analogie surprenante entre Metal et EHPAD n'est pas qu'une boutade1. Elle soulève une question fondamentale : comment transformer l'image d'un secteur stigmatisé ? Comment faire d'un rejet massif le moteur d'un succès ?
Une récente étude académique publiée dans The Conversation2 vient éclairer ce paradoxe à travers l'analyse du succès international du black metal norvégien. Ses enseignements pourraient bien révolutionner notre approche des EHPAD.
Le cas fascinant du Black Metal norvégien
Au milieu des années 1990, le Black Metal norvégien incarnait tout ce que la société rejetait : associé à des meurtres et à des incendies d'églises, ce genre musical était ostracisé dans son propre pays. Les maisons de disques norvégiennes refusaient de travailler avec ces groupes, les représentations publiques étaient limitées, et la presse ne tarissait pas de critiques.
Pourtant, quelques années plus tard, ce même black metal est devenu un phénomène mondial, avec des millions d'albums vendus. Comment expliquer ce revirement spectaculaire ?
L'étude publiée dans Academy of Management Discoveries et relayée par The Conversation attribue ce succès à un mécanisme fascinant que les chercheurs nomment "l'arbitrage de valorisation".
Concrètement, des intermédiaires (principalement des labels indépendants) ont réussi à transformer ce qui était perçu comme toxique en Norvège en atout commercial à l'international.
Leur stratégie s'articule autour de trois axes majeurs :
La réinterprétation de la stigmatisation : Les liens criminels de certains membres, loin d'être minimisés, ont été utilisés comme preuve d'authenticité. Ce qui était un scandale en Norvège devient un gage de sincérité artistique à l'étranger.
L'exploitation des différences de perception : Ces entrepreneurs ont compris que ce qui est inacceptable sur un marché peut être valorisé sur un autre, où les codes culturels diffèrent.
L'investissement dans le risque : Alors que les grandes maisons de disques fuient ces artistes par crainte pour leur réputation, de petits labels voient une opportunité là où d'autres ne voient qu'un danger.
Comme le souligne l'étude, cette démarche n'est pas idéologique mais purement financière : ces intermédiaires identifient une opportunité de marché là où les acteurs établis ne voient qu'un risque de réputation.
L'EHPAD : un cas d'école de stigmatisation
Tournons-nous maintenant vers nos EHPAD. La situation est étrangement similaire. Les scandales médiatiques comme celui d'Orpéa3 ont renforcé une image déjà largement négative. Malgré cela, la demande ne faiblit pas fondamentalement - elle se transforme.
Le paradoxe est saisissant : l'EHPAD est simultanément :
Rejeté comme symbole du "mal vieillir"
Reconnu comme nécessité incontournable
Sous-fréquenté (avec des TO en berne)
Et pourtant, sans alternative systémique crédible à grande échelle
Cette situation rappelle étonnamment celle du black metal norvégien : un produit stigmatisé sur son marché naturel, mais qui pourrait potentiellement trouver sa valeur ailleurs ou autrement.
L'analyse des données du secteur révèle d'ailleurs un phénomène intriguant : pendant que les entrepreneurs innovants évitent soigneusement de créer des EHPAD, préférant se tourner vers des alternatives (habitat inclusif, services à domicile renforcés), ils manquent peut-être l'opportunité de réinventer l'institution de l'intérieur.
Comme je l'ai écrit dans une précédente newsletter : "Quand Elon Musk décide de révolutionner l'automobile, il crée... une voiture. Certes électrique, mais une voiture." Pourtant, dans le domaine des personnes âgées, on préfère contourner l'EHPAD plutôt que de le transformer.
Je l’ai écrit dans cette newsletter :
Appliquer l'arbitrage de valorisation aux EHPAD
Et si nous appliquions les leçons du black metal norvégien au secteur des EHPAD ? Voici comment les trois stratégies identifiées pourraient se traduire:
1. Réinterpréter la stigmatisation
La médicalisation intensive, souvent critiquée, pourrait être réinterprétée comme un gage de sécurité ultime. Ce qui est vu comme une "hospitalisation perpétuelle" pourrait devenir "l'expertise médicale permanente" - un argument particulièrement percutant après une pandémie qui a révélé notre vulnérabilité collective.
L'aspect institutionnel, autre point de critique, pourrait être valorisé comme une "communauté organisée" où l'individu n'est jamais abandonné à lui-même, contrairement à un maintien à domicile parfois synonyme d'isolement.
2. Exploiter les différences de perception selon les publics
L'étude sur le black metal révèle que sa stigmatisation en Norvège n'empêchait pas son succès à l'international, où le public percevait différemment les mêmes caractéristiques.
Pour les EHPAD, il ne s'agirait pas de marchés géographiques différents, mais de segments de clientèle distincts. Ce qui rebute les seniors autonomes pourrait rassurer les familles d'aidants épuisés. Ce qui effraie les personnes en début de perte d'autonomie pourrait séduire celles confrontées à des pathologies lourdes nécessitant une surveillance constante.
Cela implique une segmentation beaucoup plus fine des établissements et de leur communication, pour adresser spécifiquement ces différents publics avec des messages adaptés à leurs perceptions.
3. Investir là où les autres reculent
Dans le cas du black metal, les petits labels ont saisi l'opportunité créée par le retrait des majors. Pour les EHPAD, l'équivalent serait d'investir dans l'innovation là où les grands groupes se contentent de reproduire les modèles existants.
Le parcours réglementaire pour créer un EHPAD est certes complexe - comme je l'ai détaillé dans mon article "Pourquoi personne ne crée l'EHPAD dont tout le monde rêve ?" - mais cette complexité même pourrait devenir une barrière à l'entrée protégeant les innovateurs audacieux.
Et si, au lieu de contourner les EHPAD, les entrepreneurs innovants s'attaquaient directement à leur transformation ? Des "arbitres de valorisation" pourraient émerger, réinventant le concept même d'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
Les nouveaux arbitres de valorisation du secteur
Qui pourraient être ces arbitres de valorisation dans le monde des EHPAD ? Certainement pas les grands groupes établis, trop engagés dans le modèle actuel et souvent échaudés par les scandales récents.
Plus probablement :
Des entrepreneurs issus d'autres secteurs, apportant un regard neuf (hôtellerie de luxe, tourisme expérientiel, communautés en ligne)
Des professionnels de santé frustrés par le système actuel et motivés à le transformer
Des collectifs de familles s'organisant en coopératives pour créer des établissements sur-mesure
Des acteurs internationaux important des modèles qui fonctionnent ailleurs
Leur mission serait comparable à celle des labels qui ont promu le black metal norvégien : transformer ce qui est perçu comme une tare en avantage concurrentiel, en ciblant des publics pour qui cette caractéristique constitue une valeur.
Pistes concrètes pour les "arbitres" potentiels
Comment ces arbitres de valorisation pourraient-ils procéder ? Voici quelques pistes inspirées du cas du black metal:
L'hyper-spécialisation thématique : Des EHPAD entièrement dédiés à une passion ou un mode de vie (musique, gastronomie, spiritualité, écologie...) transformant l'enfermement perçu en immersion choisie.
La confrontation assumée : Plutôt que de minimiser la fin de vie, certains établissements pourraient choisir de l'aborder frontalement, proposant un accompagnement philosophique et spirituel proactif.
L'inversion du contrôle : Des établissements où les résidents seraient statutairement les décideurs, inversant la relation de pouvoir qui suscite tant de craintes.
La transparence radicale : Des EHPAD entièrement ouverts au public, filmés 24h/24 (avec consentement), transformant le sentiment d'opacité en garantie de qualité.
La segmentation extrême : Des micro-EHPAD ultra-spécialisés sur certains types de pathologies, devenant des centres d'excellence reconnus.
Conclusion : Changer de regard pour changer la réalité
L'exemple du black metal norvégien nous enseigne une leçon précieuse : la stigmatisation n'est pas une fatalité. Elle peut même devenir un puissant levier de différenciation et de création de valeur quand elle est réinterprétée par des intermédiaires audacieux.
Les EHPAD sont aujourd'hui dans une situation comparable à celle du black metal norvégien des années 1990 : rejetés par leur public naturel, critiqués par les médias, fuis par les acteurs conventionnels. C'est précisément cette situation qui crée l'opportunité.
Comme les petits labels qui ont parié sur des groupes que tout le monde rejetait, de nouveaux entrepreneurs pourraient parier sur une réinvention radicale des EHPAD, transformant leurs supposés défauts en qualités distinctives.
L'étude publiée dans The Conversation nous rappelle que "la motivation pour soutenir un produit stigmatisé est financière plutôt qu'idéologique".
En d'autres termes, il ne s'agit pas d'aimer les EHPAD pour les transformer, mais d'y voir une opportunité là où d'autres ne voient qu'un problème.
Au fond, n'est-ce pas la définition même de l'entrepreneuriat ?
J’en ai d’ailleurs déjà parlé en juin 2022 dans cette pépite : Hellfest - Silver économie, même combat ?
Parier sur le Noir, quelles leçons tirer du succès de la musique Black Metal Norvégienne ? // Par Stoyan V. Sgourev - paru dans The Conversation du 14 avril 2025
Scandale Orpéa dont j’ai étudié les causes profondes dans cette enquête : Qui a vraiment profité du succès des Fossoyeurs ? paru le 19 avril 2023